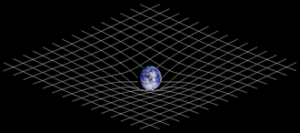Visite chez ma psychiatre hier, en début d’après-midi. Je n’ai attendu que quelques secondes, dans une salle d’attente glaciale et sans fenêtres. Le cabinet est situé dans une maison assez ancienne, rénovée de manière approximative. Dans son bureau, qui n’était pas bien éclairé, nous étions deux ombres face à face. Les discussions ont duré une quarantaine de minutes. Je n’avais pas grand-chose à dire. Je lui ai remis mon dossier médical. Elle était plutôt optimiste sur ma situation, en constatant le cheminement positif depuis 1998, année pendant laquelle j’avais commencé à décompenser sérieusement.
Aujourd’hui, j’étais un peu lasse de tous ces médecins que j’avais vu depuis cette époque. Je voulais juste un suivi pour ma prescription médicamenteuse et continuer à percevoir mon allocation. J’étais plus ou moins équilibré. Je ne souffrais plus et n’était pas angoissé. Je savais cependant que je pouvais encore décompenser, que je n’étais pas complètement à l’abri. Avec le temps, j’avais appris à vivre avec. J’avais tellement souffert, au point parfois d’avoir attenté à ma vie, que la situation actuelle ma suffisait. Je n’avais pas beaucoup de vie sociale et financièrement, j’avais juste de quoi payer l’essentiel. J’étais heureux car depuis plusieurs mois, je ne m’étais pas plié en deux de douleur dans mon canapé. Le soir, je profitais de mes soirées et n’allait pas me réfugier dans mon lit à peine le soleil couché.

Les médecins et les psychologues veulent que je sorte plus, que j’en fasse plus. Ce n’est pas eux qui sont dans le bus, quand j’ai une crise d’angoisse qui pourrait me faire décompenser. J’avais tant de fois été à la limite. J’avais passé des années complètes dans un autre monde, celui des délires. Aujourd’hui, mon cerveau a partiellement repris une configuration qui m’autorise à avoir de petits moments de bonheur.
Je me contente de cela, c’est tellement énorme et inespéré.